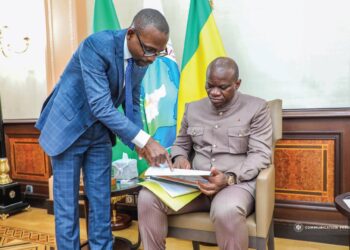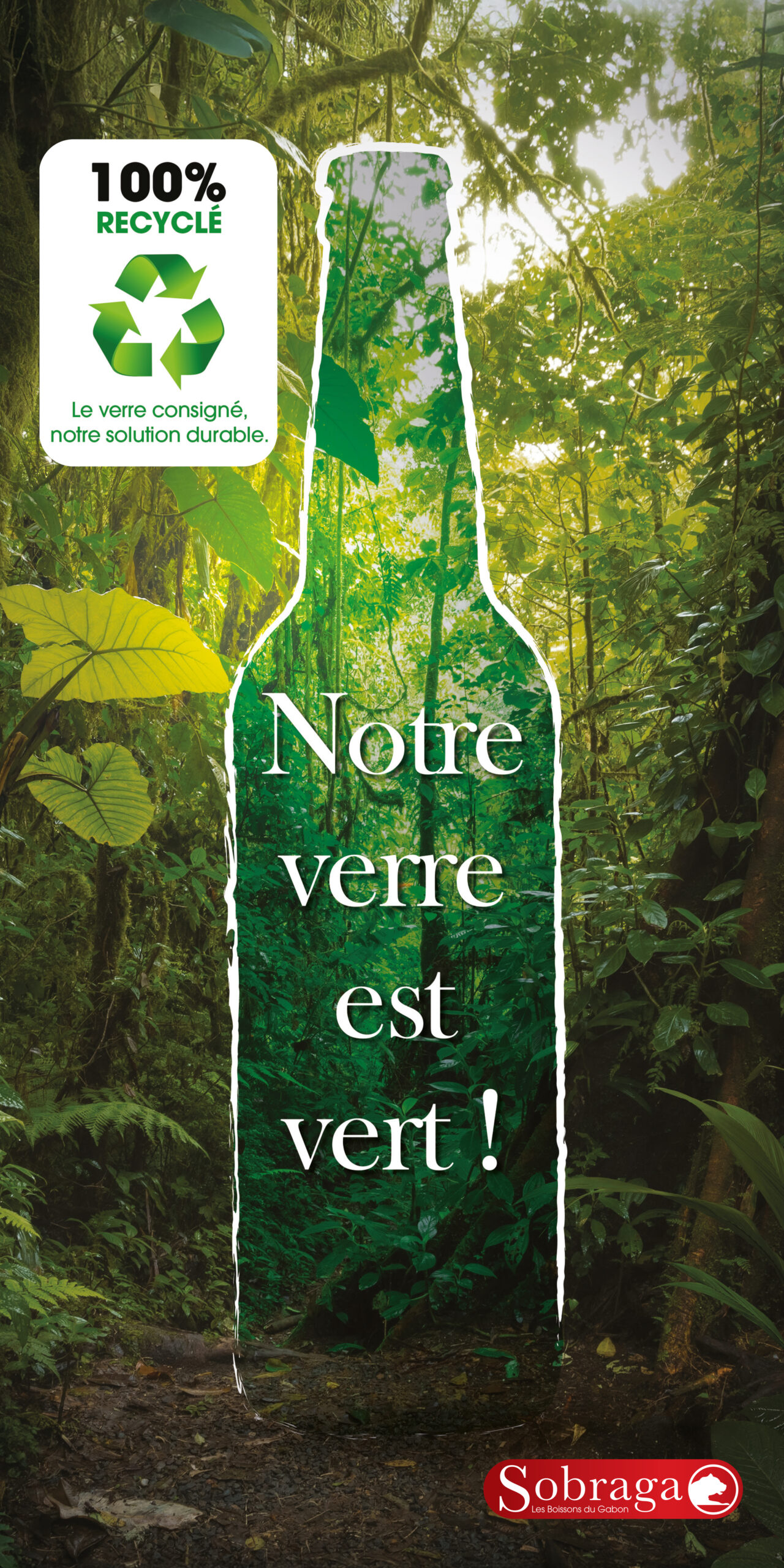Au Gabon, la question du climat semble être devenue à la fois un label de prestige à l’international qu’un terrain de flou institutionnel. Depuis plus d’une décennie, le pays s’est imposé comme un acteur climatique crédible sur la scène internationale par la ratification précoce de l’Accord de Paris, la participation active aux différentes COPs et conférences et ateliers sur le climat, à l’élaboration d’un Plan Climat national, à la promotion de la REDD+, la mise en avant de ses puits de carbone forestiers… Sur le papier, l’engagement est irréprochable. Mais dans les faits, la machine climatique gabonaise semble grippée.
Au niveau national, deux entités coexistent sans réelle synergie : d’un côté, le Conseil National Climat (CNC), créé en 2010, rattaché à la présidence de la République, l’autre, le un ministère de l’Environnement, de l’Écologie et du Climat aux contours institutionnels flous. Résultat : des chevauchements de missions, des luttes d’influence internes, et un pilotage parfois à vue se fait ressentir. Une incohérence structurelle qui nuit à la lisibilité des politiques climatiques et à leur efficacité opérationnelle.
Or, les enjeux sont immenses. Le Gabon est l’un des rares pays au monde à afficher un puits net de carbone supérieur à 100 millions de tonnes de CO₂ par an, grâce à son épais manteau forestier. Mais que rapporte réellement cette performance climatique à sa population ? Que tire le pays de cet avantage comparatif climatique ? La question dérange, mais elle est essentielle à être posée.
En effet, À quoi sert-il de figurer en tête des classements écologiques si cela ne se traduit pas par des financements transparents, des emplois durables et une montée en compétence nationale ? Trop souvent, les projets climatiques sont pensés pour répondre aux exigences des bailleurs ou des partenaires techniques internationaux, sans une réelle gestion participative. Inverser ce visage est pourtant possible. Cela passe par la remise en ordre des organes institutionnels, par un programme national d’actions climatiques ambitieux et coordonné, par la création d’une base de données climatique nationale, et par une évaluation rigoureuse des flux financiers verts. L’objectif : savoir d’où viennent les financements, à quoi ils serviront, qui en bénéficieront. Et surtout, quel est l’impact réel sur la résilience du pays et le quotidien des Gabonais ?
Plus encore, il faut former les jeunes. Le carbone, disent certains experts, sera le « pétrole de demain ». Et pourtant, parmi les étudiants en environnement ou en QHSE, rares sont ceux qui savent expliquer ce qu’est un crédit carbone, un inventaire GES ou un marché volontaire. C’est un déficit de connaissance à combler si le pays est soucieux de l’avenir. Car finalement, le climat n’est pas une vitrine, ni une posture diplomatique mais un chantier économique, scientifique, social. Il faut le sortir des bureaux, le reconnecter au terrain et le transformer en bénéfices concrets.
Wilfried Mba Nguema