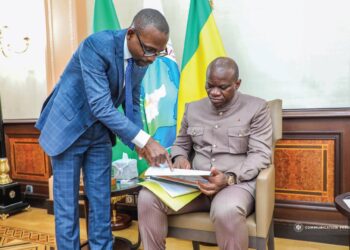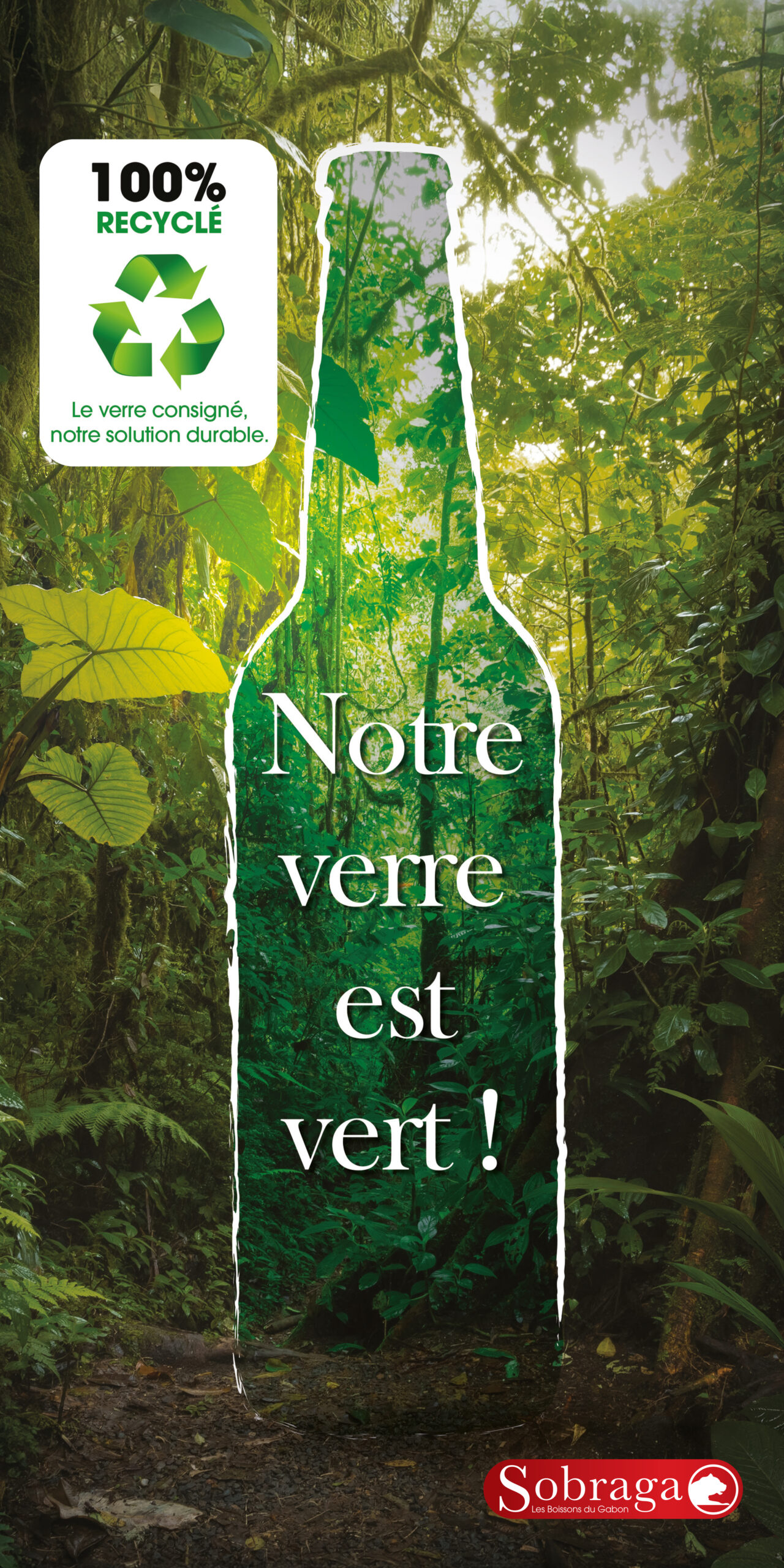C’est devenu un geste banal, presque mécanique. D’un doigt, on déverrouille son téléphone. On scrolle, on like, on partage une vidéo sur la fonte des glaces, un post engagé contre la déforestation ou une pétition contre les mines à ciel ouvert dans un coin du monde. L’intention est louable et peut-être sincère. Pourtant, l’objet même qui permet cette prise de parole en dit long sur nos contradictions.
Dans nos poches, nos sacs ou sur nos bureaux, ces petits concentrés de technologie racontent une autre histoire. Celle d’un enfant, quelque part dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), qui extrait à mains nues le cobalt qui alimente nos batteries. Celle d’une nappe phréatique en Bolivie, à moitié asséchée par l’extraction de lithium pour répondre à notre appétit de mobilité « verte ». Celle, enfin, d’une biodiversité écrasée sous les roues de notre modernité.
En apparence, nous sommes du bon côté. Celui de la prise de conscience, de l’engagement, des débats enflammés sur le climat. On marché pour la planète, nous votons pour le climat, on éduque nos enfants au tri sélectif. Mais dans le même élan, on commande nos téléphones en ligne, changeons d’ordinateur tous les deux ans, et exigeons une technologie toujours plus rapide, plus performante, plus légère et plus luxueuse. L’ironie est là, flagrante, presque dérangeante : « c’est avec les outils du désastre que nous dénonçons le désastre ».
Loin de condamner ou de juger, cet article veut surtout pointer une évidence dérangeante : nous sommes tous impliqués. Directement ou indirectement à la destruction de la nature, chacun alimentant ce système à sa manière. En achetant, en consommant, en ignorant — parfois par nécessité, souvent par choix.
Et pourtant, il serait trop simple de désigner des coupables. Trop facile de pointer du doigt les multinationales, les États, ou les industries. Car au fond, chacun d’entre nous portons une part du paradoxe. « Nous voulons une transition écologique, mais sans renoncer au confort qu’offre la technologie. Nous souhaitons un monde plus juste, tout en fermant les yeux sur l’injustice lointaine qui rend notre quotidien plus fluide. Nous voulons ralentir, mais nous vivons à toute vitesse », explique Michael Moukouangui M., Journaliste, spécialiste des questions environnementales et Prix FSC.
Dans cette mécanique mondiale, les responsabilités sont diffuses, les causes emmêlées, les effets parfois invisibles. « L’injustice climatique ne se lit pas toujours dans les températures ou les courbes scientifiques, mais dans les veines épuisées des sols africains, dans les visages marqués de ceux qui n’ont jamais vu l’électricité, mais creusent pour qu’un autre poste une story à la lumière bleue d’un écran dernier cri », ajoute le Journaliste.
Et parce que cette contradiction est universelle, elle nous oblige à plus d’humilité. Non, il ne s’agit pas de jeter son téléphone ni de vivre en ermite. Il s’agit peut-être, simplement, de reconnaître que même en militant pour la vie, il nous arrive d’y participer à sa mise en danger. Ce constat n’annule pas l’engagement. Il le rend plus complexe, plus lucide, plus humain.
Alors, avant de scroller la prochaine info écolo en dégustant son café équitable, une question mérite d’être posée, doucement : Et si nous commencions par admettre que sauver la planète implique d’interroger ce que nous appelons le progrès ? Peut-être par cette lucidité douloureuse mais nécessaire, la lutte écologique sera une affaire d’humilité. Parce que oui, parfois, l’arme la plus redoutable contre la planète, c’est notre propre bonne conscience.
Wilfried Mba Nguema