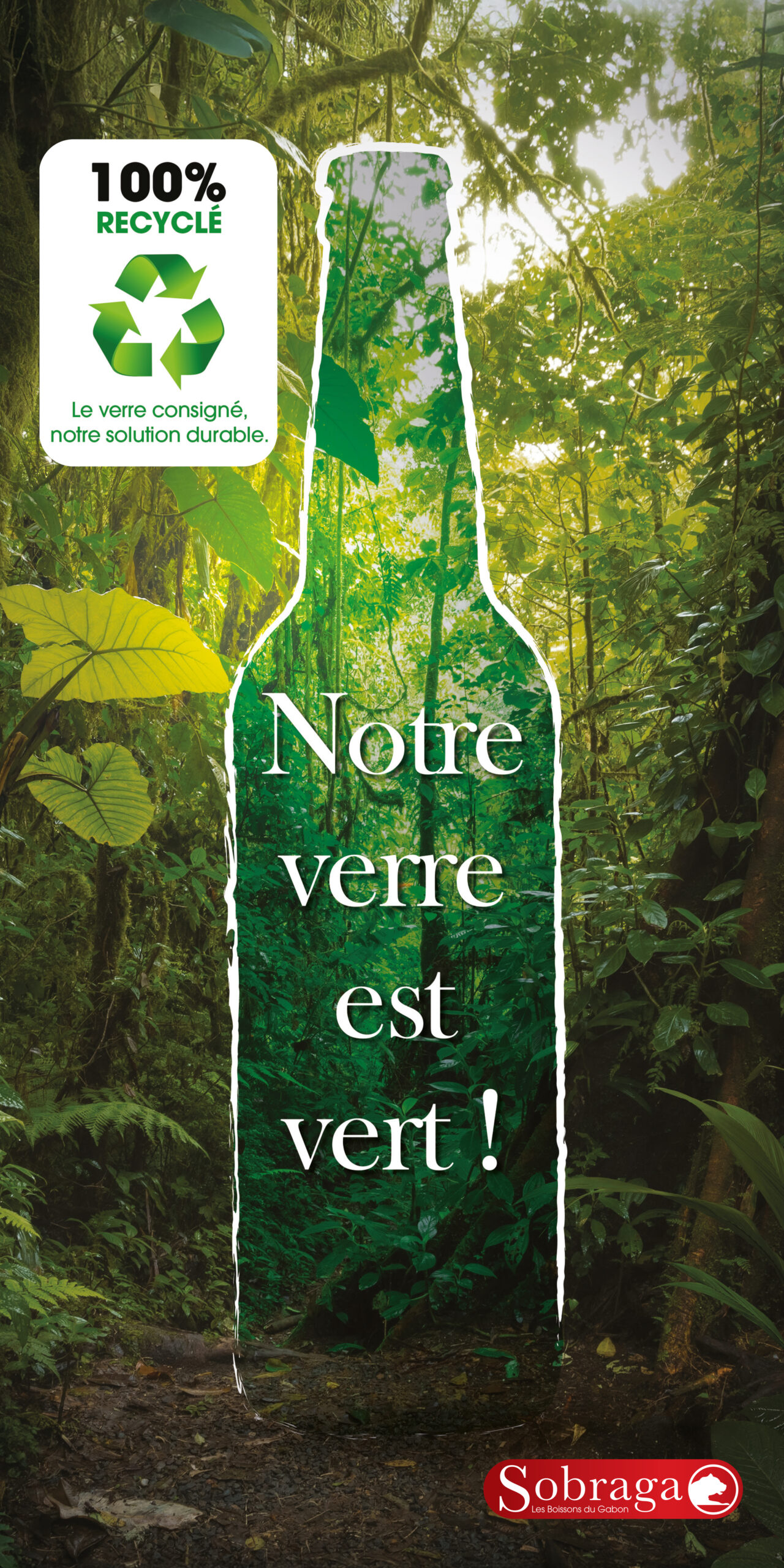Pour la première fois depuis l’indépendance, le Gabon reconnaît officiellement trois variétés locales de riz. Plus qu’un geste technique, cette décision porte une charge symbolique, économique et sociale forte : elle affirme la capacité du pays à puiser dans ses propres ressources pour nourrir son peuple et bâtir un récit collectif.
L’annonce est passée presque discrètement, mais elle marque un jalon historique important du pays. Le ministère de l’Agriculture a validé l’homologation de trois variétés de riz, inscrites au premier catalogue national des semences du Gabon. Sept années de recherche scientifique, menées par des équipes locales sous l’égide du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST), trouvent ainsi leur aboutissement.
« Aujourd’hui, on a notre arrêté. C’est le tout premier catalogue national des variétés du Gabon, le premier depuis les indépendances. Pendant que d’autres en sont à leur vingtième ou centième édition, nous posons enfin notre première pierre », confie un chercheur impliqué dans le projet, soulignant l’importance historique de cette reconnaissance.
Au-delà des résultats de laboratoire, c’est un choix politique assumé. Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a placé la souveraineté alimentaire au cœur de son projet de développement national. Pour lui, développer une agriculture enracinée dans le terroir est autant une question de sécurité qu’un levier de cohésion. « Développer notre propre agriculture est une priorité. Il s’agit non seulement de nourrir la population, mais aussi de sécuriser notre économie », insiste le commissaire général du CENAREST.
Mais la portée de ce projet ne se résume pas qu’à l’aspect économique. Car pour la première fois, le riz (aliment quotidien de millions de Gabonais) porte une identité locale reconnue par l’État. Il ne s’agit plus seulement de consommer, mais de consommer ce que l’on a soi-même produit et validé. Dans un pays longtemps habitué à dépendre de l’extérieur pour son alimentation, ce changement a une valeur symbolique forte : il réaffirme l’importance du sol, du travail paysan et de la recherche nationale comme fondements du vivre-ensemble.
Le ministère de l’Agriculture compte désormais transformer cette avancée en mouvement social et territorial. Le partenariat annoncé avec le Programme national de soutien à l’agriculture familiale (PENSAF) illustre cette volonté d’ancrer le projet au plus près des communautés rurales. « Ce partenariat va nous permettre d’estimer les besoins logistiques et humains, et surtout d’accompagner le processus pour que la production de riz passe rapidement à une échelle industrielle », explique un cadre du ministère.
Derrière cette ambition, se dessine un autre enjeu : celui de la transmission. Le riz local peut devenir un levier pour retenir la jeunesse dans les zones rurales, valoriser les savoir-faire des familles agricoles et redonner une dignité sociale à des métiers longtemps considérés comme marginaux. C’est là sans doute le sens le plus profond de cette initiative : faire du riz un ciment social, un récit commun où l’alimentation devient un outil d’identité et de cohésion.
L’avenir dira si le pari sera tenu. Mais déjà, l’image est forte : un peuple qui commence à écrire son histoire agricole avec ses propres semences. Et, à travers un aliment aussi universel que le riz, une nation qui se réconcilie avec sa terre et affirme son droit à la dignité.
Wilfried Mba Nguema