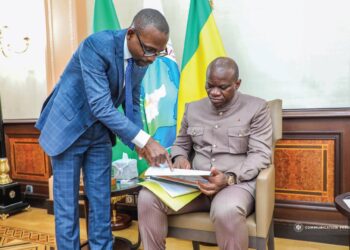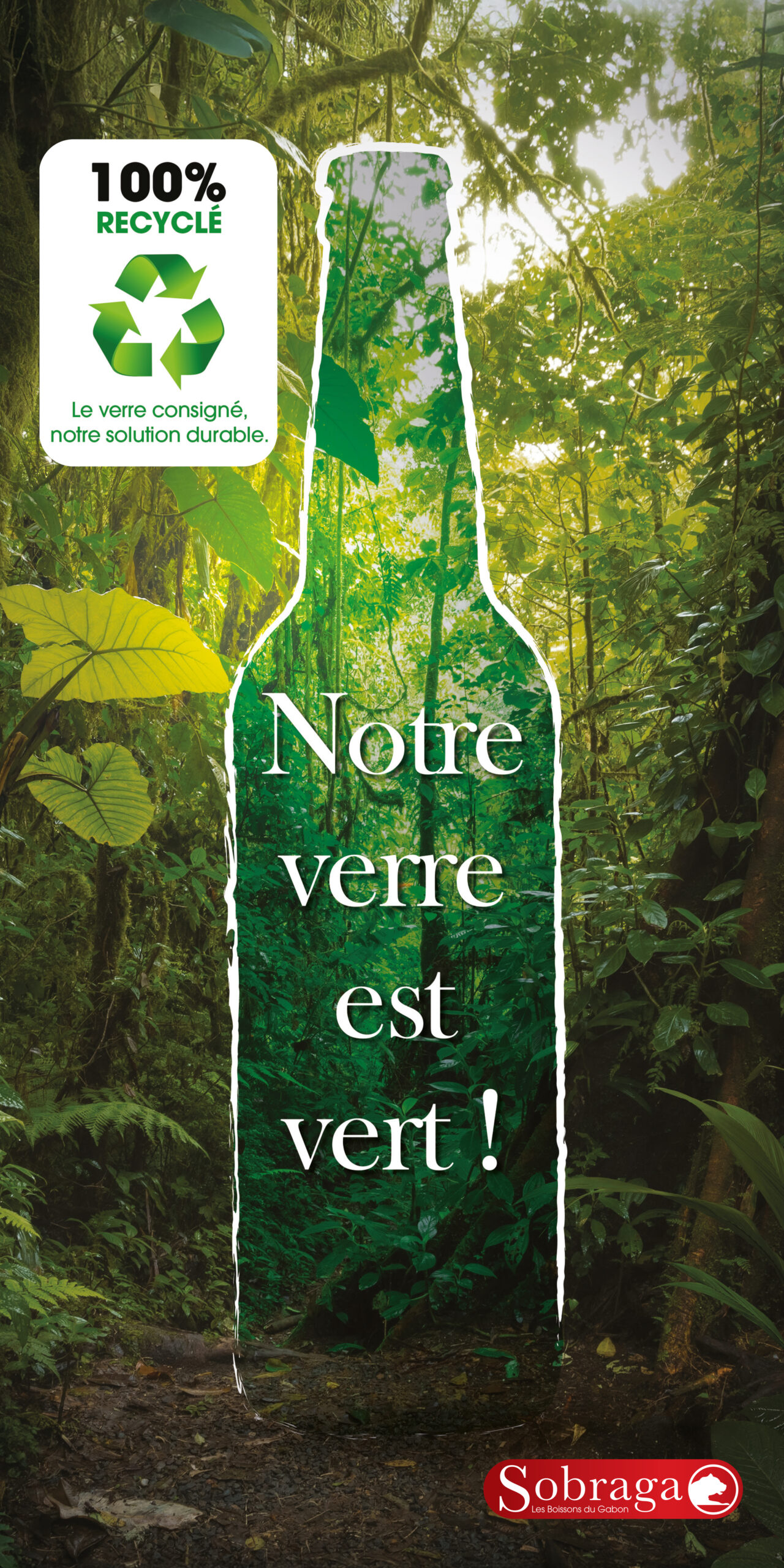On parle beaucoup de forêts, de carbone et de biodiversité, mais presque jamais des sols qui les soutiennent. Pourtant, leur dégradation menace la production agricole, la résilience climatique et la survie des écosystèmes. Au Gabon, pays forestier stratégique, cette question devient un révélateur des limites des engagements internationaux en matière d’environnement.
Les sols sont la fondation de la vie terrestre. Ils assurent non seulement la production agricole et la sécurité alimentaire, mais jouent également un rôle clé dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité
Leigh Winowiecki, responsable de l’équipe Santé des sols et des terres de CIFOR‑ICRAF, rappelle avec force que « la prise en compte de la santé des sols est essentielle et doit être intégrée aux décisions de cette COP ». Cette alerte prend un relief particulier pour le Gabon, hôte du One Forest Summit en 2023, où la France avait formulé plusieurs engagements pour la protection des forêts tropicales, aujourd’hui appelés à être revisités à la lumière des enjeux de terrain.
Les sols de stockent le carbone, retiennent l’eau et soutiennet les cycles hydrologiques. Cette capacité conditionne directement la résilience des écosystèmes et des communautés humaines. Pourtant, cette richesse invisible reste trop souvent ignorée dans les négociations internationales, et les mécanismes de financement, tels que ceux mis en place lors du One Forest Summit, privilégient encore largement la conservation forestière et la protection des espèces.
Les sols africains, et particulièrement ceux du Gabon et du bassin du Congo, sont soumis à une pression multiple. La déforestation, l’urbanisation rapide, l’agriculture intensive et la mauvaise gestion des intrants dégradent progressivement leur fertilité. Le changement climatique amplifie ces effets, exposant les terres à l’érosion et à la perte de matière organique. Les conséquences sont immédiates et lourdes : la productivité agricole diminue, les sols libèrent du carbone au lieu de le stocker, et la biodiversité, pilier de la régénération naturelle, s’effondre. La fragilité des sols transforme ce qui devrait être un levier de résilience en facteur de vulnérabilité.
Dans ce contexte, le bilan du One Forest Summit révèle une limite notable. Si la France et le Gabon ont pris des engagements ambitieux — financement des Partenariats de Conservation Positive, création de mécanismes de certificats biodiversité, lancement de l’initiative scientifique One Forest Vision pour cartographier les stocks de carbone et de biodiversité — la santé des sols n’y figure pas comme domaine d’action autonome. Le plan de Libreville évoque la « dégradation des terres » mais sans préciser de mécanismes de restauration ou de suivi des sols. Cette omission représente un angle mort qui risque de compromettre l’efficacité globale des politiques climatiques et de conservation forestière.
L’avertissement de CIFOR‑ICRAF est donc clair : protéger les forêts sans restaurer et entretenir les sols revient à s’attaquer aux symptômes plutôt qu’aux causes. Pour le Gabon, pays fortement forestier et doté d’institutions scientifiques actives, cette lacune offre à la fois un défi et une opportunité. Repositionner la santé des sols dans les engagements internationaux pourrait permettre d’aligner la protection des forêts, la sécurité alimentaire et la résilience climatique dans une approche intégrée. Cela nécessite de prévoir des indicateurs nationaux, d’éligibiliser la restauration des terres aux financements existants et de promouvoir des pratiques agricoles régénératrices, telles que l’agroforesterie.
À l’heure où les engagements du One Forest Summit sont passés à la loupe, l’inclusion des sols dans les stratégies franco-gabonaises pourrait devenir un marqueur de crédibilité. La COP30 offre l’occasion de replacer cette question au centre des discussions, soulignant que la durabilité des forêts, la stabilité des communautés et la lutte contre le changement climatique dépendent avant tout de la santé de la terre qui les soutient. Les sols, longtemps oubliés, apparaissent alors comme la condition indispensable à la réussite des engagements environnementaux et climatiques.
Wilfried Nguema