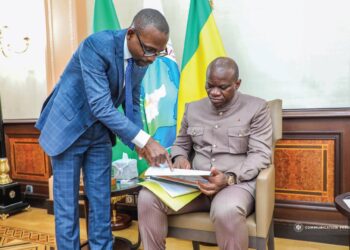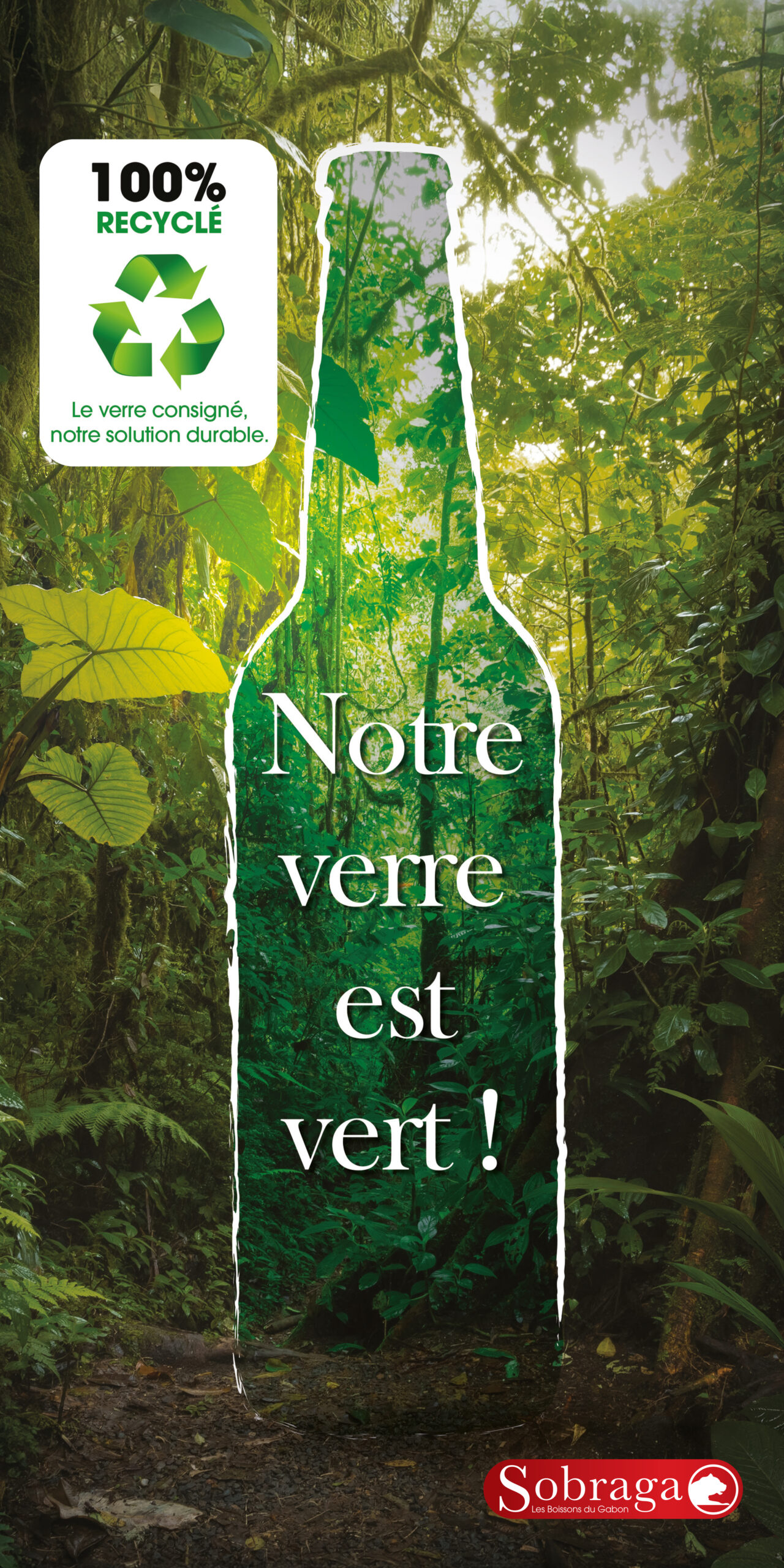À Belém, en marge de la forêt amazonienne meurtrie par les incendies et la déforestation, les négociations de la COP30 ont une nouvelle fois confirmé un déséquilibre persistant : malgré des données scientifiques désormais incontestables, le bassin du Congo demeure le grand oublié de la diplomatie climatique mondiale.
Depuis des décennies, l’Amazonie est présentée comme le « poumon de la planète ». Une expression devenue réflexe, parfois performative, tant la réalité écologique s’est éloignée du mythe. En vingt-cinq ans, la forêt sud-américaine a perdu près d’un cinquième de sa superficie, grignotée par les feux géants, l’expansion agricole, l’exploitation minière et les routes tracées au pas de charge.
Selon de récentes études, certaines zones d’Amazonie émettent désormais davantage de CO₂ qu’elles n’en absorbent, un renversement historique. Et pourtant, tout continue de s’y jouer : grandes annonces, panels à forte audience, engagements financiers massifs. À Belém, l’aura symbolique de la forêt brésilienne domine les débats, comme si la géographie décidait de la hiérarchie des urgences.
Un paradoxe scientifique et politique
Pourtant, le véritable cœur carbone de la planète n’est plus en Amérique du Sud, mais bien en Afrique centrale. Le bassin du Congo, qui s’étend sur six pays, stocke chaque année près de 600 millions de tonnes de CO₂, soit deux fois les émissions annuelles de la France. Ses tourbières, parmi les plus vastes du monde, renferment jusqu’à 30 milliards de tonnes de carbone, une bombe climatique dont l’intégrité conditionne l’avenir global.
Mais la reconnaissance politique reste inversement proportionnelle à l’importance écologique. La région est évoquée dans les textes officiels, mais sans engagements financiers structurants. Les délégations africaines se succèdent aux tribunes, mais peinent encore à imposer une voix commune. À la COP30, elles n’ont bénéficié ni du même espace médiatique ni de l’attention diplomatique accordés aux pays amazoniens.
Une mécanique d’invisibilisation
Ce déséquilibre n’est pas nouveau. Il s’enracine dans plusieurs réalités : L’hégémonie brésilienne sur la scène environnementale internationale; la fragmentation politique des pays du bassin du Congo, incapables de parler d’une seule voix; l’intensité des réseaux scientifiques et militants occidentaux en Amazonie, contrastant avec un internet institutionnel plus discret en Afrique centrale; la géopolitique du financement climat, qui privilégie les zones les plus médiatisées plutôt que les plus efficaces. Résultat : le poumon qui fonctionne est ignoré, celui qui s’essouffle reste glorifié.
Une région qui protège mais qui reçoit peu
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : L’Amazonie a reçu plus de 3,4 milliards de dollars en fonds climatiques sur la dernière décennie. Le bassin du Congo, pourtant bien plus performant, n’en a obtenu qu’une fraction marginale.
Cette asymétrie crée une situation paradoxale où les pays d’Afrique centrale financent majoritairement eux-mêmes leurs politiques de conservation. Dans le même temps, ils sont incités — parfois par les mêmes institutions — à exploiter davantage leurs hydrocarbures et leurs minerais pour pallier l’insuffisance des financements verts.
Les contradictions internes ne doivent pas masquer l’essentiel
Certes, le bassin du Congo fait face à ses propres défis : gouvernance forestière inégale, exploitation minière parfois opaque, pressions démographiques, expansion des concessions agro-industrielles. Mais ces limites, bien réelles, ne justifient pas l’angle mort international.
D’autant que les communautés locales, souvent en première ligne, portent une gestion traditionnelle qui a permis la préservation de vastes territoires restés intacts.
L’urgence d’un rééquilibrage diplomatique
Le contraste entre Amazonie médiatisée et Congo invisibilisé traduit moins un manque d’intérêt scientifique qu’un déficit de volonté politique. Et pourtant, l’avenir climatique mondial dépend directement de l’intégrité du bassin du Congo.
Sans un rééquilibrage des financements, des priorités et des alliances, la région pourrait être contrainte d’arbitrer entre préserver la planète et financer son propre développement. Au-delà des slogans, l’enjeu est simple : là où l’Amazonie s’embrase, le bassin du Congo protège encore. Ne pas reconnaître cette réalité relève moins de l’oubli que d’une forme d’aveuglement collectif.
Wilfried Nguema M.