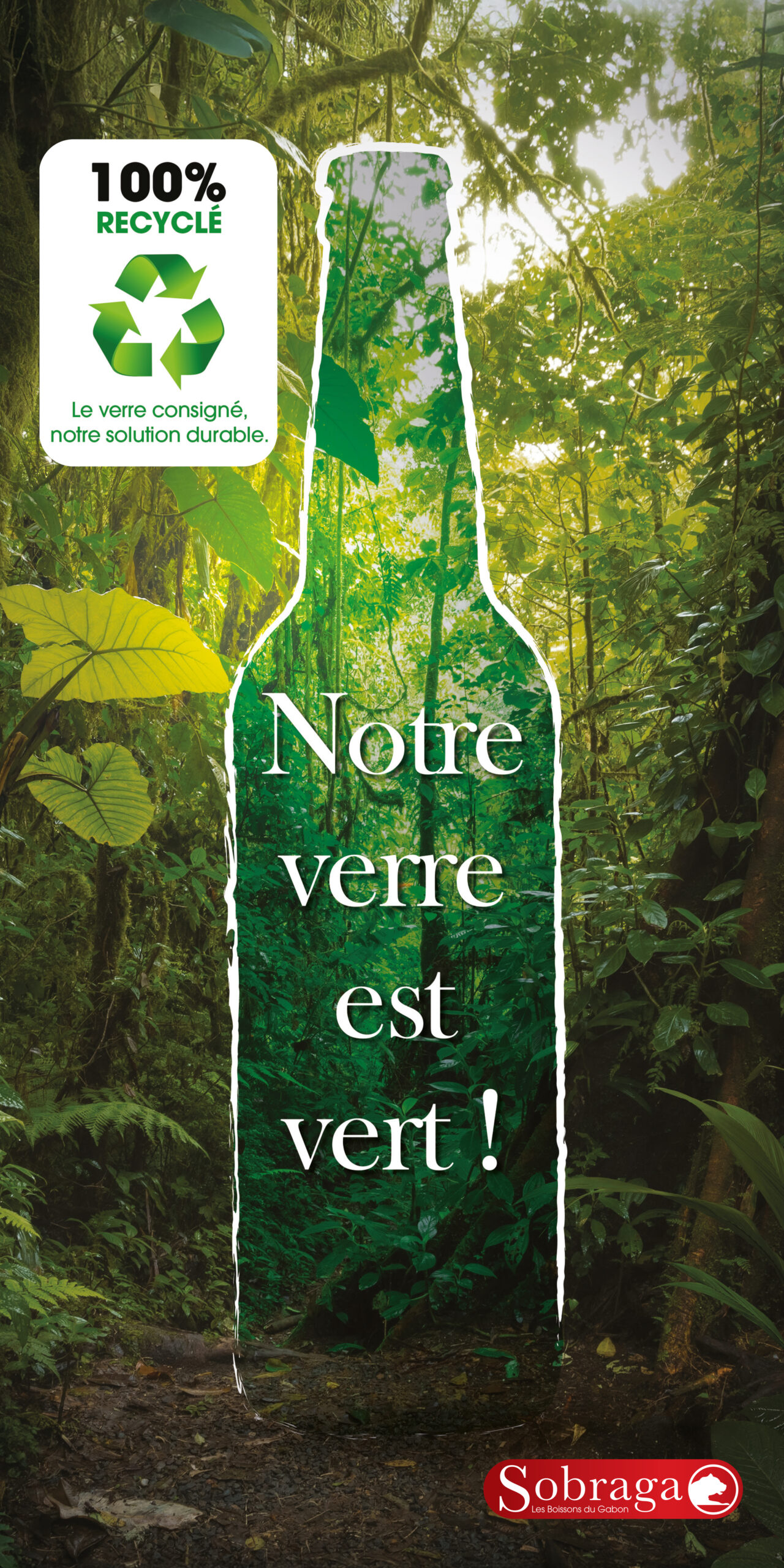Alors que l’édition 2025 de « L’état des forêts du bassin du Congo » publié par L’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (OFAC) et diffusé par le Centre de Recherche Forestière Internationale et le Centre International de Recherche en Agroforesterie (CIFOR-ICRAF) vient de paraitre, les discussions tenues à Libreville révèlent un décalage persistant entre les engagements pris par les États d’Afrique centrale au niveau international et leur mise en œuvre concrète. Si les intentions sont affichées, les limites structurelles, politiques et institutionnelles freinent leur efficacité.
L’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (OFAC) a dévoilé la nouvelle édition de son rapport biennal intitulé « L’état des forêts du bassin du Congo ». Axé cette année sur l’application des conventions internationales par les États d’Afrique centrale, l’ouvrage se présente comme une évaluation approfondie des efforts de la région face aux enjeux environnementaux mondiaux. Si le document dresse un état des lieux richement documenté, il révèle aussi, en filigrane, les limites structurelles et politiques qui entravent l’effectivité de ces engagements.
En effet, les États d’Afrique centrale ont signé la majorité des instruments internationaux majeurs en matière d’environnement – climat, biodiversité, lutte contre la désertification – mais peinent à les mettre en œuvre de manière satisfaisante. Richard Aba’a Atyi, Chercheur au Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), l’a formulé sans détour : « les accords sont effectifs, mais les pays d’Afrique centrale ne remplissent pas leurs obligations. » Parmi les manquements, il cite notamment l’insuffisance des rapports périodiques pourtant exigés par les conventions, ce qui nuit à la crédibilité des pays sur la scène internationale. Cette déclaration met en lumière une réalité préoccupante : les engagements internationaux prennent souvent une valeur symbolique, davantage motivée par des opportunités de financement ou des impératifs diplomatiques que par une volonté ferme de réforme interne.
Par ailleurs, l’absence de synergie entre les pays d’Afrique centrale constitue une autre limite majeure. L’exemple de l’accord sur le contrôle forestier, décrit comme « complètement mort » par le Chercheur illustre les écueils d’une coopération régionale moribonde. Chaque pays semble privilégier des actions nationales, souvent redondantes ou inefficaces, au détriment d’une stratégie commune. Or, face à des défis transfrontaliers tels que la déforestation, les trafics de bois ou la criminalité environnementale, une approche isolée réduit considérablement l’impact des politiques publiques.
À cela, s’ajoute la lenteur des progrès institutionnels dans plusieurs pays. Le rapport met pourtant en avant les efforts de structuration autour des questions climatiques : atténuation, adaptation, financement carbone. Selon Denis Sonwa, également Chercheur au CIFOR, on observe une « structuration institutionnelle graduelle ». Cependant, cette lente évolution interroge, surtout dans un contexte d’urgence climatique croissante. Les réformes nécessaires sont freinées par des lourdeurs administratives, une faible coordination intersectorielle et, souvent, un manque de volonté politique. Les outils existent sur le papier, mais peinent à produire des effets concrets.
Dans le même esprit, le chapitre consacré aux marchés carbones et à la biodiversité ouvre la voie à de nouveaux mécanismes de financement, mais soulève aussi plusieurs interrogations. Le rapport plaide pour une convergence entre ces deux dimensions, appelant à éviter les approches cloisonnées. Néanmoins, les marchés carbone restent largement inaccessibles aux pays du bassin du Congo, en raison de l’absence de systèmes fiables de certification, de transparence ou de gouvernance.
De plus, cette logique marchande, centrée sur les crédits carbone, tend à réduire la forêt à sa seule valeur économique, au détriment des droits des communautés locales et peuples autochtones, et des fonctions sociales et culturelles des écosystèmes. Cette dépendance à l’extérieur est d’ailleurs renforcée par le rôle déterminant du projet RIOFAc 2, financé par l’Union européenne, dans la réalisation de la publication. Si ce soutien est essentiel, il pose la question de la durabilité des actions entreprises. En effet, que se passera-t-il lorsque les bailleurs se retireront ? La viabilité des dispositifs mis en place dépendra de leur appropriation réelle par les États et de leur intégration dans les budgets nationaux.
De façon concrète, cette édition 2025 de « L’état des forêts du bassin du Congo » a le mérite de poser les bonnes questions. Elle révèle un engagement juridique fort, une expertise régionale croissante et une volonté de suivre les dynamiques mondiale. Mais elle expose aussi les carences structurelles, l’inefficacité des cadres de mise en œuvre et l’absence de vision régionale cohérente. À l’heure où les forêts du bassin du Congo jouent un rôle vital dans la régulation climatique mondiale, il est plus que jamais nécessaire que les engagements pris à l’international se traduisent en politiques concrètes, transparentes et concertées.
Wilfried Mba Nguema