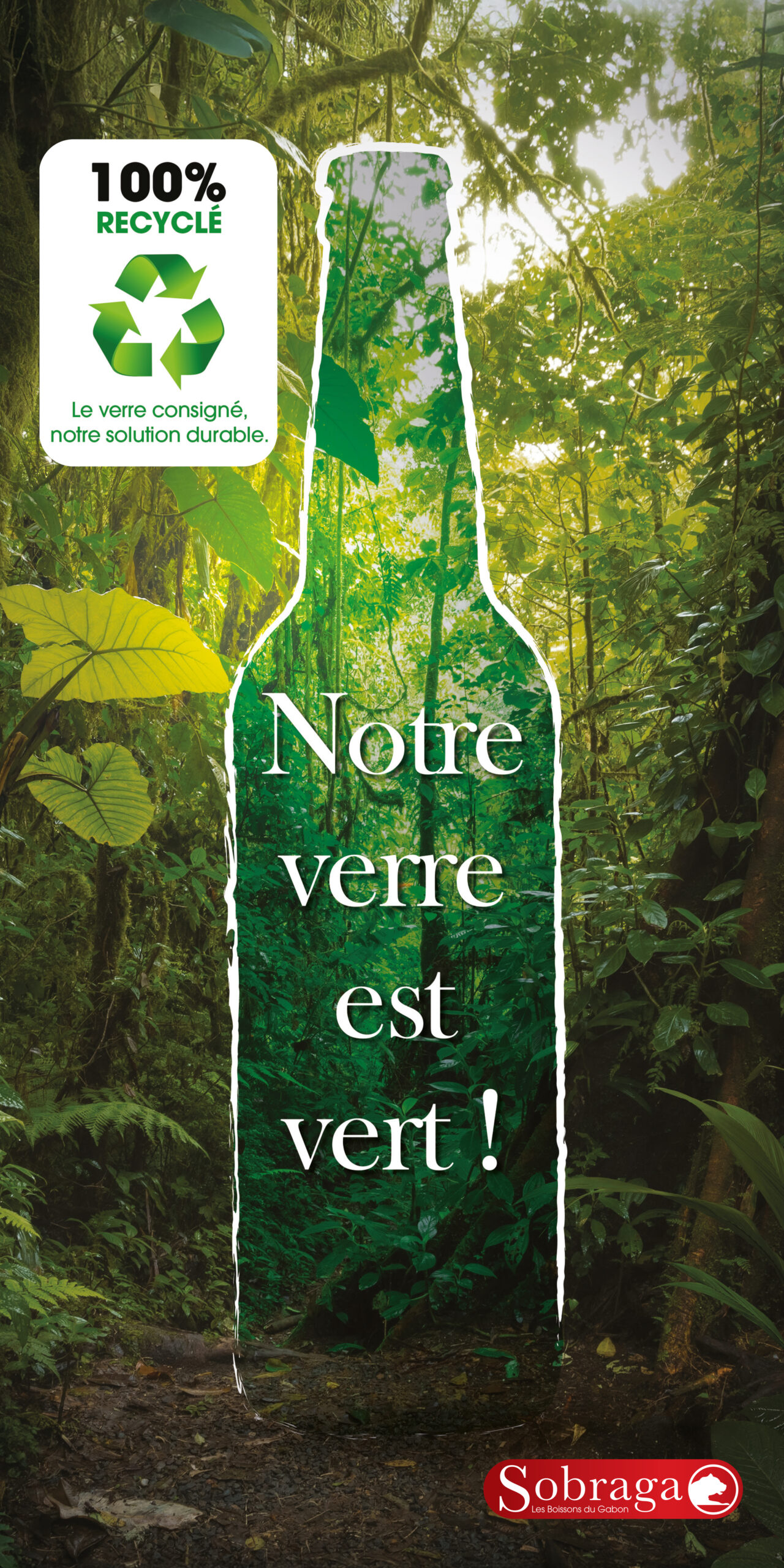A l’initiative de l’Organisation communautaire OELO, avec l’appui technique de l’AES et la collaboration des ministères des Pêches (DGPA) et des Eaux et Forêts (DGEA), financée par Tusk et la JRS Biodiversity Foundation, avec le soutien du PNUD et du Fonds pour l’environnement mondial, des pêcheurs des lacs Adolet, Ezanga, Gomé et Onangué ont récemment suivi une formation de collecte des données. Cette initiative a permis à ces acteurs, de mieux être outillés sur la gestion durable de la ressource, afin, parallèlement, de gérer durablement les stocks halieutiques disponibles et restaurer la biodiversité de ces écosystèmes humides.
Les cinq lacs sont situés dans le plus grand site Ramsar du Gabon, une zone humide d’importance internationale qui assure la subsistance et les activités génératrices de revenus de milliers de personnes dans le département de l’Ogooué et Lacs. La pêche de poisson a toujours été la principale activité au sein de ces lacs et depuis plusieurs années, la ressource disponible fait l’objet d’une mauvaise gestion. Conséquence : baisse du nombre et de la qualité des poissons dans les lacs se sont fait ressentir en raison des mauvaises pratiques. « Nous attrapions beaucoup de tilapias femelles et de petits poissons qui n’étaient pas encore matures », reconnaît Angwe Martial, collecteur de données de longue date sur le lac Oguemoué, qui a dirigé la formation.
La formation, une planche de salut
La formation en collecte de données est une véritable bouffée d’oxygène pour la régénération de la ressource. Si à ce stade, il est impossible de situer la gravité du problème, celle-ci permettra cependant d’aider à préserver les stocks halieutiques disponibles et à restaurer la biodiversité dans l’un des écosystèmes humides les plus importants du pays. Suivie des prises, collecte des données sur les espèces capturées, taille des poissons, technique de pêche et prises accessoires sont notamment les rudiments qui ont été enseignés aux pêcheurs de sorte pour ces derniers, de réviser leurs pratiques. Toute chose facilitée par les outils numériques tels qu’une tablette et application mobile. « La collecte de données sur le lac est importante. Si nous ne connaissons pas les stocks et ce qui reste dans le lac, nous ne pouvons pas aller de l’avant. Grâce à la collecte de données, j’ai compris l’importance de laisser les individus plus âgés et plus gros afin d’assurer une meilleure reproduction » a déclaré Angwe Martial, collecteur de données de longue date sur le lac Oguemoué, qui a dirigé la formation.

La formation, prémices vers des Plan de gestion
La formation et les données de référence initiales, associées à la création de nouvelles coopératives de pêche communautaires, constituent les premières étapes essentielles à l’élaboration de plans de gestion des pêches. Ces plans sont élaborés par les communautés avec le soutien des ONGs, des autorités régionales et nationales afin de réglementer où, quand et comment la pêche peut être pratiquée. Cela contribue à la reconstitution des stocks halieutiques, ce qui permet aux communautés de tirer un meilleur revenu des lacs tout en protégeant leurs écosystèmes naturels. La formation s’est en effet appuyée sur le succès avéré de l’OELO au lac Oguemoué, où les plans de gestion des pêches élaborés par les coopératives locales ont considérablement amélioré les prises tout en protégeant l’écosystème du lac. L’approche de l’OELO, connue sous le nom de « Notre Lac, Notre Avenir », combine l’organisation communautaire et la surveillance scientifique, à travers des discussions communautaires afin de comprendre les préoccupations locales et les connaissances des pêcheurs sur leurs lacs. Ensuite, avec un soutien juridique et technique, les communautés lacustres forment des coopératives de pêche et commencent à surveiller elles-mêmes les ressources. Ce processus aboutit à l’élaboration de plans de gestion des pêches qui sont reconnus, publiés au journal officiel et applicables.
Sur les sentiers du Lac Oguemoué
La nouvelle formation visait à reproduire ce succès sur cinq nouveaux lacs où les communautés ont demandé l’aide de l’OELO pour gérer le déclin de leurs pêcheries. Pour Heather Arrowood, la Directrice exécutive de l’OELO (Organisation Ecologique des Lacs et de l’Ogooué), ces lacs ont les mêmes défis que ceux du lac Oguemoué. « Les poissons sont plus petits et plus rares, et les gens doivent travailler plus dur et recourir de plus en plus à des méthodes de pêche destructrices pour obtenir les mêmes prises. En travaillant avec les communautés pour qu’elles collectent leurs propres données, nous leur fournissons les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe et décider comment y remédier. C’est une victoire pour les communautés lacustres, mais aussi pour le gouvernement, qui bénéficie de données fiables et d’une gestion durable », explique la directrice avec amertume.
Durabilité partagée au sein des lacs
Pour Franck Bengone, Président de l’une des premières coopératives de pêche du lac Oguemoué, qui a contribué à diriger la récente formation, il existe désormais une nouvelle cohésion entre les différents villages et entre les coopératives autour d’un objectif commun. Cela est d’autant plus perceptible que les défis et enjeux liés à la conservation des ressources halieutiques posent de nombreux enjeux, tant économiques que sociaux.  « Nous avons désormais des objectifs communs, les membres de la coopérative pêchent avec des matériaux durables et capturent des poissons de qualité. Nous plantons à l’aide de barrières électriques anti-éléphants et nous élevons des abeilles. La pêche est désormais mieux organisée et la majorité des gens respectent le plan de gestion. Les prises ont changé, les gens mangent mieux et gagnent plus. J’encourage et soutiendrai ceux qui veulent reproduire notre modèle. C’est difficile, mais avec beaucoup de patience et une grande prise de conscience, les choses peuvent changer », a-t-il fait savoir.
« Nous avons désormais des objectifs communs, les membres de la coopérative pêchent avec des matériaux durables et capturent des poissons de qualité. Nous plantons à l’aide de barrières électriques anti-éléphants et nous élevons des abeilles. La pêche est désormais mieux organisée et la majorité des gens respectent le plan de gestion. Les prises ont changé, les gens mangent mieux et gagnent plus. J’encourage et soutiendrai ceux qui veulent reproduire notre modèle. C’est difficile, mais avec beaucoup de patience et une grande prise de conscience, les choses peuvent changer », a-t-il fait savoir.
La surveillance, une pratique pérenne
Alors que la pêche en eau douce en Afrique est soumise à des pressions croissantes dues à la surpêche, au changement climatique et à la dégradation des habitats, le modèle gabonais pourrait offrir des enseignements précieux pour la région. Et pour cause, les cinq nouveaux lacs sont à différents stades du processus de gestion durable. Certains ont déjà rédigé des accords communautaires de pêche, comprenant des zones d’interdiction volontaire de pêche et l’interdiction des techniques nuisibles. Les nouveaux collecteurs de données vont désormais recueillir chaque mois des données sur les prises qui permettront de valider ces accords et d’orienter les politiques futures. « L’approche d’OELO montre comment le partenariat avec les communautés locales peut déboucher sur des solutions gagnant-gagnant, avec une amélioration des prises de poissons et une réduction massive des pratiques nuisibles à leur environnement », a déclaré Dan Bucknell, directeur général de Tusk, qui a contribué au financement de la nouvelle formation.
Reproduire ce succès à une échelle beaucoup plus grande, avec les cinq nouveaux lacs, augmentera considérablement l’impact positif sur cet écosystème vraiment important. Toutefois, si l’objectif ultime est que le gouvernement gabonais adopte officiellement de nouveaux plans de gestion des pêches dans ces lacs, l’accent est actuellement mis sur l’autonomisation des communautés grâce à des outils et à des formations leur permettant de gérer leurs propres ressources.
Michael Moukouangui Moukala